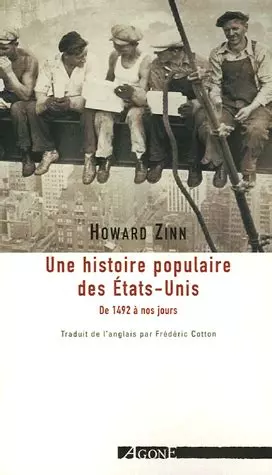Extrait de « le livre noir du colonialisme » de Marc Ferro, dépôt légal janvier 2003.
Pour « conquérir, pacifier et protéger », selon la rhétorique coloniale pour désigner la mainmise de la France sur les populations et les territoires indochinois, les Français utilisaient les antagonismes interethniques de la péninsule. Ils recrutèrent leurs alliés et collaborateurs chez les catholiques, les Khmers krom (Cambodgiens de Cochinchine) et les montagnards du nord et du centre Vietnam pour réprimer les Vietnamiens.
La domination française eut son cortège de morts au combat, d’exécutions capitales, de villages brûlés et rasés, de civils massacrés, de milliers de porteurs réquisitionnés et fusillés s’ils s’enfuyaient. La population fut décimée par le paludisme, la sysenterie, le typhus et le choléra. Le corps expéditionnaire français ne fut pas épargné.
Les colonnes militaires françaises firent du Tonkin un pays exsangue car les populations avaient déjà été éprouvées par les bandes armées chinoises. L’historien C. Fourniau cite Mgr Puginier qui notait qu’en 1884 « peut-être la moitié des villages avaient été incendiés, pillés ou rançonnés ». Il rapporte de nombreux témoignages analogues à celui-ci : « En passant dans les villages, nous avions le droit de tout tuer et piller lorsque les habitants ne venaient pas se soumettre. Aussi, nous n’avons pas manqué de poulets et de cochons. Nous partons le soir vers dix onze heures, nous allons dans les villages et nous surprenons les habitants au lit. Nous tuons tout, hommes, femmes, enfants, à coup de crosse de fusil et à la baïonnette, c’est un vrai massacre ». (cf lettréz et paysans vietnamiens face à la conquête coloniale de CH Fourniau, Paris 1989, page 22 et G Dreysfus, Lettres du Tonkin 1884-1886, Paris 2001).
Lorsque les Français donnent l’assaut à la citadelle de Hué qui abritait les palais impériaux, om la cour résidait, les rapports firent des massacres (1500 vietnamien tués ontre 11 Français), incidie et pillage de la ville. Les palais, les archives, la bibliothèque, tout un héritage culturel précieux, furent réduits en cendres. La fin de la conquête et de la « pacification » du nord et du centre du Vietnam dura de 1883 à 1896.
Le racialisme inspirait au système colonial des opinions et des comportements racistes, c’est à dire discriminatoires, offensants et parfois criminels dans les relations quotidiennes. Des Français coupables de meurter durent acquittés, soit condamnés avec sursus, soit encore tenus de verser une somme dérisoire à titre de dommages-intérpets.
Le sol et le sous-sol furent décrétés domaine de l’État et une législation appropriée en matière de concession foncière et minière réservait les activités agricoles et extractives aux Français et Vietnaiens, excluant les Chinois qui les exploitaient en quasi-exclusivité avant l’arrivée des Français. La société des Charbonnages du Tonkin détenait le quasi monopole de l’extraction et la vente du charbon tonkinois et plaçait l’Indochine au 2ième rang des producteurs de charbon d’extrême Orient derrière la Mandchourie.
Une politique très libérale installa les Français, individus et grandes société anonymes sur de vastes domaines aux dépens des petits défricheurs indigènes libres ignorant la législation ou la procédure d’immatriculation foncière, conduisant à des conflits fonciers qui atteignirent leur paroxysme en 1936-1938.
En attendant que les capitaux nécessaires aux grands travaux d’équipement fluviaux, routiers, hydrauliques et agricoles ne viennent des grandes société et des emprunts levés sur la place de Paris, ils furent issus de la fiscalité indochinoise sur le sel, l’alcool et l’opium faisant apparaître la nature oppressive du régime colonial de dénonça Ho Chi Minh en 1925.
1ère résistance : le traditionalisme monarchique
Dès la conquêt de la Cochinchine en 1859, des formes de résistances se manifestèrent : incendie de la canonnière l’Espérance qui tua 17 marins français, 1867, 1868, 1872, 1873, 1878,… Il en est de même lors des conquêtes de l’Annam et du Tonkin qui mobilisa 30 000 homes et 6500 tirailleurs tonkinois qui s’opposent à la quasi-totalité de la population, exceptée la communauté catholique très étoffée). Mais l’insurrection s’étend à tout le pays lors du passage dans le maquis du roi Ham Nghi à pzrtir du 13 juillet 1885. Mais cette résistance est battue en décembre 1886-janvier 1887 lorsque le roi accepte un combat frontal contre l’armée française. Le roi est capturé en novembre 1888, Phan Dinh Phung meurt en 1895, signant la pacification de l’Annam et du Tonkin.
Ces opération militaire sont coûté la vie à 2000 français en Cochinchine et 5000 dans l’Annam et au Tonkin pou rla suel année 1885, signe d’une résistance acharnée.
La grande dépression 1873 – 1896
Notes issues de « l’Histoire Populaire de la France » de Gérard Noiriel à partir du chapitre « Une crise de civilisation » page 390.
Dans le prolongement de la politique de libre-échange adoptée en 1860, ils signèrent de traités de commerce avec un grand nombre de pays. Le pouvoir républicain fut complètement pris au dépourvu lorsque démarra la première grande crise du capitalisme qui est restée dans l’histoire sous le nom de la « Grande Dépression » qui toucha la France avec une intensité extrême. L’historien Rondo Cameron estime que cette crise fut « l’une des plus graves qui aient jamais marqué l’histoire d’une nation industrielle ». D’après André Varagnac, au-delà de la dépression économique, c’est une véritable « crise de civilisation » mettant fin à la pluri-activité et la complémentarité entre l’agriculture et l’industrie.
Grâce à la vapeur, les nouveaux navires plus sûrs et plus rapides que les anciens bateaux à voile avaient raccourci les temps de transport transocéaniques. Encouragés par les traités de libre-échange, le commerce à large échelle se développa rapidement. Les marchandises produites à moindre coût dans les grandes usines et dans les grandes exploitations agricoles inondèrent le marché français, provoquant une crise de surproduction et donc une baisse des prix. Cette concurrence frappa durement l’agriculture. Les luttes victorieuses que les paysans avaient menées depuis la Révolution française avaient permis une forte extension de la petite propriété, mais celle-ci n’eut pas les moyens de se moderniser. Non seulement ces petits paysans avaient de plus en plus de mal à écouler leur récolte, mais les progrès techniques les privèrent brutalement de ressources ancestrales. En 1868, la découverte de l’alizarine artificielle bouleversa la fabrication de la soie en provoquant une crise mortelle de la sériciculture. Mais le virus circulant aussi vite que la monnaie et les marchandises, les campagnes françaises furent brutalement touchées par de nouveaux fléaux comme le phylloxera. La vigne dont la culture s’était étendue sous le Second Empire dans toutes les régions de France dut durement atteinte, et 30 % du vignoble français disparut en quelques années.
La Grande Dépression toucha également l’industrie. Le secteur le plus massivement atteint fut celui de l’industrie textile qui avait été le moteur de la première industrialisation. Entre 1880 et 1900 le cours de la laine baissa de 42 %, ce qui provoqua la faillite d’un grand nombre d’entreprises. Cette crise sonna dans toutes les régions de France le glas du système ancestral de la Fabrique qui associait depuis des siècles un petit nombre d’ouvriers-artisans de centre-ville et des milliers de tisserands répandus dans le villages. À Reims, entre 1876 et 1900, plus de 40 établissements de tissage manuel disparurent provoquant la ruine de 300 tisseurs du quartier saint Rémi. Dans la bonneterie troyenne, 3/4 des métiers à tisser non mécaniques cessèrent de fonctionner. La ganterie grenobloise s’effondra sous les coups de la concurrence étrangère. À Lille, les lointains successeurs des filtiers furent anéantis. Dans la région stéphanoise, la petite métallurgie qui faisait vivre des dizaines de milliers d’ouvriers-paysans ne put résister à la concurrence étrangère car elle fabriquait des fusils à 130 francs l’unité, alors que les mêmes fabriqués dans les grands ateliers de Belgique étaient vendus 85 francs.
Les entreprises s’adaptèrent en concentrant et mécanisant leurs installations. Les cousins Peugeot réorientèrent leur production de quincaillerie vers le cycle puis l’automobile en créant de vastes ateliers à Sochaux-Monotbéliard où furent rassemblés des milliers d’ouvriers. La soierie lyonnaise durement frappée en 1877 abandonna les belles étoffes pour se lancer dans la fabrication massive de tissus mélangés produits mécaniquement.Le nombre des métiers mécaniques ne cessa de croître : de 5 % en 1873 à 1/3 en 1900 et 4/5 en 1913. Dans la verrerie, le soufflage mécanique remplaça l’art traditionnel des souffleurs de verre. La baisse de la production et la chute des prix toucha également l’industrie lourde. Pour la 1ère fois depuis le milieu du siècle la production de charbon, de fonte et d’acier commença à stagner. Ce marasme eut des effets importants pour le monde ouvrier car il provoqua un retournement du marché du travail. Entre 1883 et 1887, un mineur sur quatre fut renvoyé et un ouvrier sur cinq dans la grosse métallurgie. Les patrons des mines et les maîtres de forge se séparèrent en priorité des femmes, des enfants, des migrants temporaires. C’est donc la main d’œuvre d’appoint qui fut touchée de plein fouet.
La découverte d’un immense gisement ferrière dans le bassin du Briey en Lorraine et la mise au point du procédé Thomas grâce auquel ce fer pouvait être transformé en fonte, provoquèrent une ruée des maîtres de forge vers ce nouvel eldorado. L’intervention du convertisseur Bessemer qui permettait de fabriquer de l’acier à partir de la fonte, aboutit à la construction de grandes usines du Nord et de l’Est associant hauts fourneaux, aciéries et laminoirs. Le dynamisme du fer qui avait joué un rôle important dans e dynamisme de l’industrie rurale fut alors mortellement touchée elle aussi. Les progrès de l’industrie chimique, l’utilisation de nouvelles sources d’énergie, comme l’électricité et le moteur à explosion contribuèrent puissamment au dynamisme de la seconde industrialisation. Elle entraîna une spécialisation régionale et une nouvelle division géographique du travail au détriment du Sud de la France car la crise de la pluri-activité toucha tout particulièrement des réginos comme le Languedoc, la Dordogne, l’Ardèche. Les solutions que le patronat imposa pour sortir de la Grande Dépression achevèrent de détruite le mode de production fondé sur la pluri-activité.
Des milliers d’ouvriers furent rassemblés dans ces grands établissements, permettant d’imposer aux ouvriers la discipline du travail en brisant l’autonomie que leur lien avec le monde rural leur avait laissée. La tolérance pour aller cultiver son champ fut supprimée, les amendes pour absentéisme se multiplièrent. La maison devint un logement en cité appartenant à l’usine et le jardin remplaça le champ offrant toutefois 40 % du salaire du fait des cultures des légumes et de l’élevage. Comme c’était le cas auparavant, l’inexistence d’allocations familiales, d’assurances sociales ou de retraite, ces activités agricoles furent réservées aux femmes, aux enfants et aux vieux. Pour stabiliser la main d’œuvre, le patronat encouragea la constitution de familles ouvrières, il ouvrit des écoles ménagères pour que les femmes apprennent à tenir leur foyer, encouragea l’assistance à la messe le dimanche, proposa des activités sportives et mit en place des sociétés récréatives. Les ouvriers furent contraints de se ravitailler dans les économats patronaux, défalquant les dépenses sur leur salaire. C’est de cette façon que la Compagnie d’Anzin, décrite dans le roman Germinal d’Émile Zola, espérait imposer son contrôle sur les 52 000 mineurs et ouvriers qui dépendaient d’elle en 1884.
Esclavage
J’ai tiré mes notes de « Esclaves et négriers » de Max Guérout dans la bibliothèque « voir l’histoire ».
Dans les temps anciens
En 387 avant notre ère, Platon est capturé et vendu comme esclave.
En 221 avant notre ère sous Ying Zheng des milliers d’esclaves et de bagnards participent à la construction de la grande muraille de Chine
En 72 avant notre ère, les romains, paniqués par la révolte des esclaves, crucifient 6000 hommes le long de la Via Appia.
En 46 avant notre ère, César vend plus de 50 000 esclaves en une fois sur les Gaules, le Pont (tour de la mer Noire), l’Égypte et la Numidie à l’occasion de son triomphe le plus fastueux jamais organisé.
Du XV au XIX siècle
En 1455, la traite est déclarée licite par le pape. Elle ne condamnera l’esclavage qu’en 1839.
Capturé en 1575 après à la bataille de Lépante où il perd une main, Miguel de Cervantès, surnommé le manchot de Lépante et auteur du Don Quichotte de la Manche, est racheté à Alger avec d’autres captifs en 1580.
Les esclaves sont les prisonniers des vaincus, des enfants capturés qui deviendront la troupe d’élite des Janissaires, capturés sur les navires ennemis chrétiens quand on est musulman ou l’inverse.
En 1492, le roi d’Espagne finance l’expédition de Christophe Colomb qui aborde sur une île qu’il baptise Hispaniola, aujourd’hui Haïti indépendante en 1804 dont la partie occidentale est Saint Domingue. Dans les années qui suivent, les amérindiens sont employés de force dans les mines et les plantations. Mais en 1550 sous Charles Quint, suite de la controverse de Valladolid, il est interdit d’imposer travail et conversion au catholicisme aux indiens. Les espagnols auront désormais recours aux esclaves africains. Toutefois, dès 1505, la 1ère cargaison de captif africains quitte l’Espagne pour Saint Domingue.
Depuis la publication du Code noir en 1685 jusqu’en 1848, on considère que le noir est un homme tandis qu’en droit c’est un meuble.
Le sort des esclaves
Les négriers redoutent la traversée d’Afrique jusqu’à l’Amérique qui dure 2 à 3 mois pendant lesquels ils risquent de rencontrer des forbans, des maladies telles le scorbut peuvent atteindre esclaves et marins si la traversée se prolonge, sans compter les révoltes.
Des affiches et des circulaires envoyées aux planteurs informent de la vente des esclaves.
Après avoir vendus à vil prix les malades et les plus faibles, les esclaves sont présentés sur une estrade par lot de 4 ou 5 accompagnés de femmes, enfants et hommes plus âgés de moindre valeur au prix de 1200 à 2000 livres en 1761 alors qu’ils sont achetés 157 livres et que le salaire du capitaine s’élève à environ 200 livres.
Les acheteurs les palpent, les examinent, le sondent pour s’assurer de leur bonne santé, mais parfois, les captifs sont marqués d’un numéro et des billets, placés dans un chapeau sont tirés au hasard. En 1785, à Port au Prince, Saint Domingue, un négrier nantais vend 6 hommes et 3 femmes pour 21 000 livres dont 1/3 est payé comptant, 1/3 à six mois et le dernier à 1 an. Les noirs sont « estampés » d’une étoile.
Aussitôt achetés, les esclaves sont marqués une seconde fois au fer rouge, puis conduits vers les plantations de leur propriétaire, ou, moins nombreux vers les mines.
Extrait du Code noir
Article 36 : les vols de moutons, chèvres,… faits par des esclaves pourront être condamnés à être battus de verges et marqués d’une fleur de lys.
Article 38 : l’esclave qui aura fuité 1 mois aura les oreilles coupées et sera marqué d’une fleur de lys à une épaule. S’il récidive, il aura le jarret coupé et sera marqué d’une fleur de lys sur l’autre épaule. À la 3ième fois, il sera puni de mort.
Fin de l’esclavage
Dès la fin du XII siècle, des voix s’élèvent contre l’esclavage. La traite est abolie en Angleterre en 1807, mais il faudra attendre 1833 pour qu’il soit supprimé dans le colonies anglaises.
Brissot, en France crée la société des Amis des Noirs en 1788 et soumet un projet de loi à l’Assemblée en 1790. En 1791, une révolte des esclaves éclate en Guadeloupe et à Saint Domingue. L’esclavage y est aboli en 1793, puis dans toutes les colonies françaises. Napoléon Bonaparte le rétablira en 1802, pis l’abolira à nouveau en 1815 suite au traité de Vienne qui demandait aux États européens d’interdire le trafic humain sur les côtes africaines.
À l’interdiction, répond la traite illégale dans tous les pays riverains de l’Atlantique. Toutefois, les capitaines des navires capturés par la Royal Navy se voient interdire tout commandement, les captifs trouvés à bord libérés et conduits en Sierra Leone par les Anglais et en Guyane par les Fraçais. Le Sierra Leone, créé pour accueillir les esclaves libérés en 1790 en accuillera 96 000.
En 1821, une goélette américaine saisit 4 navires négriers français en Sierra Leone.
En janvier 1822, un capitaine est dégradé et condamné à 10 ans de prison pour avoir débarqué 13 noirs à l’île Bourbon.
En 1832, un navire français sous pavillon espagnol qui se livrait à des opérations de traite en Sierra Leone est envoyé à Brest pour y être jugé.
En 1839, la France est condamnée pour avoir recruté des Africains pour se troupes coloniales en Guyane et l’équipage emprisonné.
La répression menée par la France et l’Angleterre a permis à 160 000 Africains d’échapper à l’esclavage. Une fois libres en Sierra Leone, les Anglais les forcent à s’engager comme « travailleurs libres » aux Caraïbes. Les Français emploient les esclaves jusqu’en 1823, puis emploient les « libres astreints à un engagement » à partir de cette date.
Les engagés
Alors même que l’esclavage est aboli au XIX siècle, l’économie des plantations est en pleine expansion. Pour recruter la main d’œuvre nécessaire, les planteurs se tournent vers le travail « volontaire » d’esclaves provenant de négriers illégaux ou l’engagement de travailleurs Indiens, Chinois, Malgaches, Africains et Mélanésiens.
En 1844 en Sierra Leone, tous les Africains saisis sur les navires négriers seront invités à émigrer ou à justifier qu’ils sont en état de pourvoir à leur nourriture. Toute allocation en nature leur sera refusée.
L’Angleterre capture autour de 40 négriers illégaux dont ils contraignent les esclaves ainsi libérés d’émigrer aux Antilles avec un engagement de 5 ans. Les engagés sont recrutés à l’initiative des États ou des colons qui passent des contrats avec des intermédiaires pour leur transport depuis l’Inde ou la Chine. Les règlements officiels imposent un contrat de travail d’une durée limitée à 5 ou 6 ans, un salaire, une protection en cas de maladie et un droit au retour. Dans la réalité, le travailleur ne sachant pas lire est remis au planteur qui acquitte le prix du voyage qui sera retenu sur son salaire de même, parfois, que sa nourriture et ses vêtements qu’il achète dans le magasin tenu par l’employeur. Il se trouve ainsi avoir une dette perpétuelle qui remet en cause son droit au retour.
Entre 1811 et 1834, les Antilles ont reçu 799 000 africains, 543 000 indiens, 180 000 européens, 145 000 chinois, 58 000 africains libres et 32 000 japonnais.
Au XIX siècle, le Mexique autorise les contrats de travail de 99 ans en pouvant être résiliés qu’à l’initiative de l’employeur. Ces contrats admettent le principe de la servitude pour dettes.
Saint Domingue
Ces notes sont issues de wikipédia
Vers 1680, désertée par les colons espagnols, la France impose sa présence militaire dans l’ouest d’Hispaniola, au détriment des Espagnols, et des Anglais. De 1680 à 1700, les gouverneurs désarment progressivement les flibustiers afin de développer une économie de plantation orientée notamment vers le sucre.
Après que l’Espagne cède ce territoire à la France le 20 septembre 1697 la colonie de Saint-Domingue prend une place de premier plan dans la production sucrière française et même mondiale, employant en 1788 plus de 400 000 esclaves et 22 000 affranchis.
À partir de 1720, Saint-Domingue est le premier producteur mondial de canne à sucre. Au milieu du XVIIIe siècle, l’île exporte à elle seule autant de sucre que toutes les îles anglaises réunies et devient la principale destination des traites négrières via le commerce triangulaire. Ainsi, jusqu’en 1791, plus de 860 000 esclaves y furent importés, soit près de 45 % de la totalité des esclaves importés par la France dans ses colonies (environ 2 millions).
Avant la révolution, les produits coloniaux de Saint-Domingue représentent un tiers des exportations françaises. En 1799, Saint-Domingue produit la moitié du café et du coton mondial et le tiers du sucre.
L’indépendance proclamée le 1er janvier 1804 n’est pas reconnue par la France. Entre février et avril, informé du projets d’annihilation de la population noire par un contingent français resté sur l’île, la quasi-totalité des Blancs restant de l’ancienne colonie est massacrée. Entre 3000 et 5000 personnes seront tuées ainsi que les femmes et les enfants auxquels l’amnistie avait été promise.
Plusieurs milliers ont fui ou ont péri dans l’insurrection de Saint-Domingue ; beaucoup se sont réfugiés dans l’Est de Cuba avec leurs esclaves et ont repris la production des denrées coloniales. Cuba a ainsi importé autant d’esclaves qu’en deux siècles.
Sous la menace d’une déclaration de guerre, Haïti accepte le paiement d’une indemnité aux familles qui sera ramenée à 90 millions de francs en 1838. Le paiement de cette indemnité a entraîné un important retard de développement dans le pays.
Cuba 1er exportateur de sucre
Ces notes sont issues de « Capitalisme, esclavage et sucre à Cuba » de Rémy Herrera chargé de recherche au CNRS.
Les esclaves noirs africains ont très probablement été introduits à Cuba dès la conquête de l’île, en 1511, pour y travailler dans les mines d’or. Le cycle de l’or à Cuba, c’est la période 1511-1540 avec un pic en 1525. Mais, l’effondrement démographique de la population indigène amérindo–cubaine est tel (peut-être plus de 200 000 individus en 1510, à peine 15 000 en 1530) que les représentants des classes dominantes originelles réclament l’accroissement des flux migratoires de travailleurs forcés indiens (des Caraïbes), et surtout esclaves (d’Afrique). On évalue à 60 000 personnes la population africaine déportée (et arrivée vivante) à Cuba de la conquête à 1760.
Au XVII ème siècle, Cuba produit du cuir, mais surtout vers les cultures destinées à l’exportation : tabac, indigo, plus tard café, et, dès 1511 le sucre. La canne à sucre a peut-être été introduite dès le second voyage de Colomb à Cuba, en 1494. Les femmes seront souvent domestiques ou prostituées.
L’histoire du commerce du sucre est celle d’une lente translation des échanges de l’Inde (principal producteur jusqu’au XVème siècle) vers la Méditerranée, sous l’impulsion des marchands perses, puis arabes, puis italiens, Vénitiens surtout, qui détiennent dès la fin du XIVème siècle un quasi monopole pour le commerce sucrier et la proto-industrie du raffinage, et qui vont peu à peu contrôler aussi les centres de production.
Les grandes expéditions maritimes ibériques déplaceront les plantations sucrières de la Méditerranée vers les îles de la circumnavigation de l’Afrique (à Madère, où Colomb est propriétaire de plantations et d’esclaves), vers les îles atlantiques où la culture de la canne ne se fera plus que sur une base exclusivement des travailleurs esclaves noirs africains, ensuite vers le Brésil et les Caraïbes, dans les possessions hollandaises (Anvers remplace Lisbonne pour le raffinage au début du XVIIème siècle), puis anglaises (la Barbade, puis la Jamaïque) et évidemment françaises (Haïti). Haïti est en 1789 le plus gros producteur mondial de sucre, sur la base d’une structure de classes composée à 90% d’esclaves noirs dans un système hyper–répressif.
Cuba va prendre la suite d’Haïti pour la production du sucre et devient le premier producteur mondial dès 1840-1850. Trois raisons expliquent sa spécialisation dans la mono–production de sucre.
La demande croissante de l’Europe provoque une forte augmentation des exportations que permet l’entrée massive d’esclaves à Cuba. Tandis que Cuba compte environ 30 000 esclaves en 1760, après la prise de la Havane en 1762, les Anglais en introduisent près de 15 000 en 10 mois, à partir de leurs marchés négriers de Virginie, de la Jamaïque, de la Barbade, contrôlés depuis Londres, Liverpool et Bristol. Avant 1760, six bateaux étaient enregistrés par an à l’entrée du port de La Havane, ils seront plus de 200 en 1763. Les exportations cubaines sont multipliées par deux entre 1763 et 1774, par 20 entre 1763 et 1790.
En 1776, l’indépendance américaine a coupé les États-Unis des sources sucrières britanniques traditionnelles, et contribué ainsi à les connecter étroitement à Cuba. Les Nord–Américains achètent à Cuba du sucre brut non transformé en échange ils lui fournissent de quoi produire ce sucre. Des esclaves, en grand nombre payables à crédit sur les exportations futures de sucre, du matériel agricole, des denrées alimentaires pour alimenter les captifs, des caisses et des sacs pour les remplir de sucre à exporter.
La guerre d’indépendance d’Haïti, en détruisant la base systémique esclavagiste haïtienne, élimine le principal concurrent sucrier sur le marché mondial, et provoque à Cuba une expansion fulgurante des productions et des exportations de sucre. Cuba pourra en effet produire du sucre, massivement, et exporter ce sucre, massivement, parce que la guerre haïtienne a fait décupler les prix sur les marchés européens, ruiné son plus grand rival, et provoqué le départ des planteurs français, qui seront peut-être 10 000 à immigrer vers Santiago de Cuba et à s’implanter sur les terres de
l’Oriente. Ces derniers emmenèrent avec eux leur capital, en monnaie, machines et esclaves (au moins 10 000), leur technique, à l’époque à la pointe de l’agronomie tropicale, et leur réseau commercial et financier, fait de connexions puissantes avec les marchands et les banquiers européens jusque-là inaccessibles ou hostiles aux exportateurs cubains : à Bordeaux, à Marseille, à Paris ; mais aussi à Londres, à Milan, à Amsterdam. Ces immigrés français de premier choix rejoints par les grands propriétaires espagnols émigrant de la Louisiane rachetée par les États-Unis en 1800 sauront bientôt constituer une force des plus réactionnaires à l’appui des intérêts des sucriers cubains, dans leurs efforts acharnés pour maintenir et prolonger jusqu’au bout le système esclavagiste à Cuba. Le « modèle » d’exploitation caribéen perdure dans le temps en se déplaçant dans l’espace. Mais il perdure, dans les premières décennies du XIXème siècle, dans un contexte économique international en plein bouleversement, en raison notamment de la découverte d’une seconde source de sèves saccarifères à haut rendement disponible en Europe (la betterave).
Malgré de violentes crises consécutives aux fluctuations de la demande européenne, le secteur sucrier cubain connut entre 1750 et 1850 un essor tout à fait fulgurant en dépit d’une concurrence de plus en plus exacerbée, côté offre, des betteraviers d’Europe.
La production de sucre à Cuba était d’environ 12 000 tonnes en 1785, 29 000 en 1800, 44 en 1815, plus de 75 en 1830, 165 en 1840, et 268 en 1850 ; dix ans plus tard, elle atteignait 473 000 de tonnes et en 1867, un an avant le début de la guerre civile : 761 000 de tonnes exportées pour le plus grande partie. On comptait 478 centres de production (plantations, moulins et sucreries) en 1760 à Cuba, il y en avait plus de 1 000 en 1820 et 1 442 en 1846. Les profits dégagés par les classes dominantes créoles et étrangères sont proprement prodigieux grâce à l’accélération du rythme des déportations de travailleurs noirs, africains, esclaves. ils sont 64 500 lors du recensement de 1792. On compte près de 125 000 arrivées pendant la décennie 1851-1860,presque un demi–siècle après l’abolition de la traite.
Le travail des esclaves dans les plantations de sucre est si dur (la chaleur, l’humidité, le fouet, les chiens…) qu’il les tue physiquement, rapidement, par épuisement. Pour y faire face, la pratique du rapt de Noirs libres, revendus par les marchands comme esclaves aux sucriers, n’est pas exceptionnelle dans la Cuba de l’esclavagisme déclinant. Les grands propriétaires essaieront d’imiter une innovation qui fit la fortune de nombreux planteurs nord–américains et anglais : l’élevage d’esclaves noirs, par la reproduction d’étalons et de reproductrices. Mais cette expérience ne marcha pas aussi bien qu’aux États-Unis. Ces mêmes planteurs tentèrent un instant de contraindre par la loi les petits paysans pauvres blancs à venir travailler sur les terres à sucre, aux côtés des travailleurs esclaves. Mais, cela comportait de trop grands risques économiques et politiques en soudant, par des conditions de travail presque identiques, les fractions noire et blanche
du prolétariat cubain, jusque-là fonctionnellement séparées.
De l’esclavage au salariat
Il fallait que les grands sucriers importent des travailleurs de l’extérieur engagés par le mensonge (et la force) et fixés dans les plantations par la loi (et la force), via des contrats de salariat bridé (au-delà de la contrainte monétaire). Ce fut d’abord, vers 1835–1840, des paysans espagnols pauvres, des Blancs qui arrivèrent des Canaries, de Catalogne, de Galice…
Mais, soumis à des conditions de travail proches de celles des esclaves, contractuellement contraints mais statutairement libres, ils s’enfuyaient presque tous (d’où des lois interdisant le vagabondage, comme en Europe, à cette époque). À partir de 1845, des Indiens du Yucatan, prisonniers de guerre de l’armée mexicaine qui les céda aux marchands et aux sucriers cubains. Puis ce fut le tour des engagés chinois : 150 000 Cantonnais arrivèrent à La Havane, transportés par les négriers. Les profits de la traite des Jaunes étaient faramineux : les trafiquants anglais, français, nord–américains… s’en gavèrent.
Mais cet afflux de travailleurs contraints, tenus par des contrats de travail bridé extrêmement sévères et payés sous le coût de location d’un esclave
Betterave sucrière
Notes ici https://fr.wikipedia.org/wiki/Betterave_sucri%C3%A8re
Sous Napoléon III
cf Les luttes et les rêves de Michelle Zancarini-Fournel
Décidée en 1857, l’expédition française conquiert l’Indochine méridionale. Saïgon est occupée en 1859, en 1867, le Cambodge est placé sous protectorat français. Dans sa monté vers le nord, la France subit différentes défaites dont celle de Francis Garnier dans le Mékong en 1873 et le traité du 15 mars 1874 reconnait l’annexion des provinces, l’indépendance de l’Annam (Hué), la présence de la religion catholique et l’ouverture de trois ports au commerce international. Commerce, catholicisme et civilisation sont les trois buts de la colonisation. Une nouvelle expédition en 1882 occupe Hanoï et l’expansion reprend dans le nord et le centre du Vietnam actuel. l’Union indochinoise regroupe le Cambodge, la Cochinchine et l’Annam ainsi que les protectorats du Laos et du Tonkin.
À la veille de la colonisation, l’Indochine est une mosaïque de sociétés et d’États peuplés par 10 millions de Vietnamiens et de Khmers. Les Indochinoises sont systématiquement présentées dans la chanson, la littérature et la presse française comme des objets sexuels. En 1883, un médecin constate que la prostitution est partout. En décembre 1888, le résident maire de Hanoï fait enregistrer les prostituées sur les registres de la police, elles doivent effectuer périodiquement une visite médicale au dispensaire municipal avec mention sur leur carte individuelle. À Haïphong, en 1896, on coupe les cheveux des prostituées malades qu’on renvoie dans leurs villages afin de ne plus contaminer les Européens. Le rapport d’un médecin-major en 1910 fait état de prostitution masculine dans le 4ième bataillon de Vietry.
Années 1930
Notes issues de l’« Histoire mondiale du XX »
Régimes totalitaires
page 68 : Soutenus par les classes possédantes et rentières effrayées par la perspective de tout perdre, nazisme, fascisme, communisme stalinien, ces régimes dictatoriaux cherchent à contrôler les frustrations populaires en restreignant les libertés individuelles et en obtenant le soutien d’institutions religieuses et corporatistes.
La seule certitude au sujet de ces régimes totalitaires qui s’installent en 1930 est de pouvoir dire ce qu’ils ne sont pas, à savoir des États de droit, respectueux de la séparation des pouvoirs, du pluralisme politique, du suffrage universel et des libertés individuelles.
Sur le plan idéologique, tous détestent l’individualisme, la démocratie parlementaire, les valeurs bourgeoises tandis que nazisme et fascisme souhaitent un monde avec une race dominante alors que le stalinisme met en avant une classe dominante. Sur le plan économique, nazisme et fascisme ne remettent pas en cause le capitalisme, tandis que le stalinisme procède à la suppression de toute propriété privée des moyens de production avec l’étatisation complète de l’économie. Enfin, nazisme et fascisme visent la domination d’un peuple sur d’autres, alors que le but du communisme est l’abolition des différences de classes entre les hommes.
Sur le plan organisationnel, tous mettent en place un parti unique, une police politique, des camps d’internement (le goulag et Dachau sont créés en 1932 et 1933), valorisent l’encadrement de la jeunesse.
Mais la contrainte exercée ne saurait cacher la part de fascination et d’adhésion du peuple car la crise a donné l’occasion de mettre en place des programmes économiques interventionnistes dont les effets se font rapidement sentir dans les foyers. Dans l’Italie des années 1920, l’amélioration des conditions de vie dans campagnes ne peut être contestée. L’introduction des contrats de travail fait disparaitre la catégorie exploitée des journaliers agricoles, tandis que les lois exproprient les grands propriétaires des terres incultes. Le programme de bonification des terres qui s’en suit dans les zones marécageuses permet la hausse des rendements agricoles. La bataille du blé se gagne par un soutien technique (semences sélectionnées, petite mécanisation) et économique (soutien des prix) apporté aux paysans. Dans les villes, un vaste programme de rénovation urbaine et des grands travaux (autoroutes) sont pourvoyeurs d’emploi. Lors de la crise de 1931 qui frappe l’Italie, l’État crée l’Institut pour la reconstruction industrielle qui recapitalise les banques et entre au capital d’entreprises privées. Ainsi, dans l’esprit de nombreux individus, privation de libertés rime avec « bonheur totalitaire ».
Régimes démocratiques
Page 73 : En France, par exemple, l’instabilité gouvernementale chronique (34 gouvernements entre 1924 et 1936) d’origine constitutionnelle (régime parlementaire) et politique (multipartisme éclaté en une quinzaine de formations politiques), cette démocratie n’en finit pas de décevoir l’opinion publique dans un contexte de crise qui appelle des mesures énergiques. Ces facteurs expliquent l’attente d’un exécutif fort.
Il y a pourtant des expériences démocratiques remarquables. En Suède, la victoire du parti social-démocrate en 1932 conduit à la nomination d’un nouveau premier ministre Per Albin Hansonn en poste jusqu’en 1946 qui s’entoure d’économistes constitutionnalistes et pose les bases d’un état providence. Cette expérience est présentée aux États Unis comme modèle par le journaliste Marquis Childs. Le New Deal de Franklin Roosevelt élu en novembre 1932 est une rupture politique et sociale : sauvetage du monde agricole et industriel, grands travaux dans les états sinistrés, instauration de conventions collectives, interdiction de travailler aux enfants de moins de 16 ans, assurance sociale pour les veuves, chômeurs et personnes âgées, salaire minimum.